Recherche
Cette section regroupe toutes les informations relatives aux diverses facettes de la réalisation de ce projet de recherche : problématique, méthodologie, résultats, rapport final.
Problématique
Les données de recherche ont montré qu’il existe un lien entre les améliorations en éducation et le développement professionnel (DP) du personnel scolaire[1].
Même s’il ne peut à lui seul transformer le milieu scolaire, il constitue un vecteur d’optimisation des pratiques enseignantes sur lequel le système d’éducation doit pouvoir compter.
Pourtant, le perfectionnement des enseignants n’amène pas toujours des changements significatifs en classe. Le caractère morcelé et ponctuel de plusieurs activités est mis en cause. Plusieurs ne reposent sur aucune analyse de besoins et ne soutiennent pas le transfert en classe[2]. Bref, ces activités restent trop souvent fragmentées et sans liens explicites avec les besoins des intervenants scolaires[3], et ce, même si un consensus se dégage quant à son importance.
Nombreuses sont les études qui tendent à confirmer que le milieu scolaire disposerait d’un pouvoir important quant à la persévérance et la réussite des élèves[4]. Les données probantes soulignent notamment le rôle fondamental joué par la maîtrise de la langue d’enseignement au regard de la persévérance et de la réussite scolaires[5]. L’amélioration de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture s’avère l’une des interventions à prioriser pour le développement professionnel du corps enseignant.
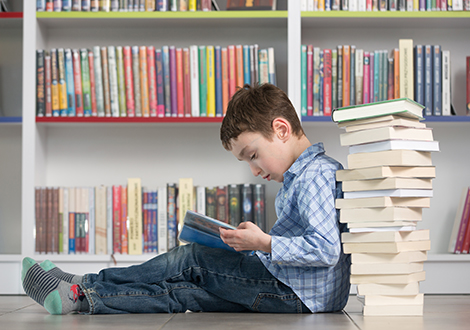
Les études en efficacité de l’enseignement ont montré que l’effet enseignant constitue le levier le plus puissant sur lequel le système scolaire peut s’appuyer pour favoriser l’apprentissage en classe[6], le développement professionnel s’avère alors un instrument de choix pour améliorer les interventions en littératie auprès des élèves.
Cependant, offrir de la formation aux enseignants est une chose. Mettre en place les moyens pour que cette formation améliore réellement la qualité de l’enseignement, de façon à influencer positivement l’apprentissage des élèves, en est une autre.

Une ligne de force émerge actuellement des études sur le DP soulignant que, pour qu’elles puissent obtenir l’effet désiré, les activités de formation continue doivent respecter deux conditions essentielles[7] :
Condition no 1
Proposer aux enseignants des contenus qui leur permettront de fonder leurs interventions pédagogiques sur des données probantes.Condition no 2
Tenir compte, dans la démarche, des principes d’implantation d’un changement durable des pratiques enseignantes en classe.
- Guskey, 2000; Borman et al., 2002; Timperley et al., 2007; Desimone et Stuckey, 2014.
- Ministère de l’Éducation du Québec, 1999.
- CSE, 2014.
- Education Trust, 2002; Hattie, 2009; Center for American Progress and the Education Trust, 2011; Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013.
- Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009; National Reading Panel, 2000.
- Hattie, 2009, 2015b; Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013; Hargreaves, 2014.
- Guskey, 2000; Joyce et Showers, 2002; Yoon et al., 2007; Timperley et al., 2007; Guskey et Yoon, 2009; Wei et al., 2009; Bissonnette et Richard, 2010; DeMonte, 2013; Richard et Bissonnette, 2014 ; Cordingley et al., 2015.
Question
Quels sont les modèles de formation continue les plus efficaces pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture chez les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire?
Afin d’être les plus exhaustifs possible, nous avons recensé tant les études sur la formation continue des enseignants que celles portant sur le DP. En nous appuyant sur les travaux de Guskey (2000), nous considérons la formation continue comme une activité de développement professionnel qui se définit plus largement comme suit : « [i]l s’agit du processus et des activités auxquelles prennent part les intervenants scolaires avec l’intention de perfectionner leurs savoirs, habiletés et attitudes professionnels, afin de pouvoir, à leur tour, favoriser l’apprentissage des élèves » (Guskey, 2000, p. 16, traduction libre).
Objectifs
Effectuer une recension systématique des écrits afin de répertorier les différents modèles de formation continue pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.
Établir quels sont les modèles de formation les plus efficaces pour l’enseignement de la lecture et de l’écriture.
Formuler des recommandations, tant sur le contenu des modèles de formation que sur la démarche andragogique qu’ils proposent, afin de fournir au milieu scolaire des balises pour maximiser la portée de la formation continue en lecture et en écriture offerte aux enseignants.
Méthodologie
Pour réaliser cette synthèse de connaissances, nous avons utilisé les principaux moteurs de recherche en éducation en anglais et en français. En outre, la publication du Handbook on Professional Development in Education en 2014 nous a permis d’avoir accès aux travaux récents des chercheurs de pointe dans le domaine. Finalement, nous avons complété notre démarche de recension des écrits par une recherche sur Google Scholar pour répertorier les publications des principaux chercheurs travaillant sur le développement professionnel des enseignants.
Pour sélectionner et analyser les études sur le DP recensées, nous avons eu recours à deux outils différents, mais complémentaires. D’une part, pour effectuer une analyse rigoureuse des stratégies pédagogiques recommandées par ces études, nous avons utilisé le système de classification des recherches à 4 niveaux élaboré par LinguiSystems en 2006. D’autre part, pour évaluer si la démarche de formation proposée par ces mêmes études respectait les conditions d’implantation d’un changement durable des pratiques pédagogiques des enseignants formés, nous nous sommes basés sur le modèle d’évaluation à 5 niveaux de Guskey (2000).
Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à consulter les rubriques suivantes :
- Le modèle d’évaluation du développement professionnel de Guskey (2000)
- La classification des recherches élaborée par LinguiSystems (2006)
La démarche méthodologique d’analyse des écrits de notre synthèse de recherche est innovatrice. En effet, le recours à la classification des recherches de LinguiSystems combiné à l’utilisation du modèle à 5 niveaux de Guskey nous a permis d’effectuer une analyse croisée particulièrement rigoureuse des études sur le DP que nous avons retenues. Grâce à la combinaison de ces deux grilles, notre examen a porté tant sur le contenu des activités de formation que sur le processus de mise en place des pratiques proposées aux enseignants, en vue de répertorier les interventions les plus efficaces permettant d’influencer positivement l’apprentissage des élèves.
Le modèle d’évaluation du développement professionnel de Guskey (2000)
Guskey (2000) a élaboré un modèle à cinq niveaux pour évaluer l’efficacité des activités de développement professionnel. Chaque niveau s’appuyant sur le précédent, l’obtention du succès au niveau inférieur représente généralement un prérequis pour l’atteinte du niveau supérieur.
-
1. Satisfaction
-
2. Apprentissage
-
3. Soutien organisationnel
-
4. Transfert des apprentissages en contexte professionnel
-
5. Retombées sur l’apprentissage des élèves
La satisfaction des participants à une activité de formation constitue le premier niveau d’évaluation du DP. Il s’agit du type d’évaluation le plus courant, le plus simple et le niveau avec lequel le milieu scolaire possède le plus d’expérience. C’est le type de données le plus facile à recueillir et à analyser. À ce stade, les questions posées se focalisent sur le niveau d’appréciation des participants. Une fois la session terminée, ont-ils l’impression d’avoir bien utilisé leur temps? Le matériel était-il adéquat? Les activités réalisées étaient-elles intéressantes? Le formateur était-il compétent? Son animation favorisait-elle la compréhension? La formation leur a-t-elle été utile?
En plus d’avoir apprécié la formation, il est à espérer que l’expérience vécue a permis aux participants d’apprendre quelque chose. À ce stade, l’objectif est d’évaluer les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être acquis par les participants lors de la session de formation. Quoique les données nécessaires à l’évaluation de l’atteinte du niveau 2 puissent être recueillies à la fin de la session, l’utilisation d’un formulaire standardisé n’est pas suffisante. Les mesures doivent faire état de l’atteinte d’objectifs spécifiques, ce qui signifie que les indicateurs d’apprentissage devraient avoir été précisés avant que l’activité ne débute.
À ce niveau, le point de mire de l’évaluation porte sur la quête d’informations concernant l’organisation et son implication dans le soutien requis pour implanter les changements prévus par la formation dans les pratiques professionnelles des participants. Les variables organisationnelles s’avèrent un élément déterminant du succès de tout programme de développement professionnel. Par exemple, le manque de soutien de la part de la direction peut venir saboter les efforts faits par les enseignants pour implanter de nouvelles stratégies pédagogiques dans l’école, même quand celles-ci sont appliquées adéquatement en classe. Ainsi, les gains obtenus aux niveaux 1 et 2 peuvent être annulés par des problèmes générés au niveau 3. Ceci explique pourquoi il est essentiel que la démarche d’évaluation du DP prévoie la collecte d’informations sur l’implication de la direction et le soutien organisationnel.
Au niveau 4, la question centrale posée vise à connaître le degré d’application dans leur pratique professionnelle des différents savoirs acquis par les participants lors de la formation. À ce stade, la clé pour recueillir des données pertinentes réside dans l’identification d’indicateurs explicites qui révèlent tant le degré que la qualité d’implantation des applications. En d’autres mots, comment peut-on savoir si ce que les participants ont appris lors de la formation est utilisé et appliqué adéquatement? Contrairement aux niveaux 1 et 2, ces informations ne peuvent être recueillies à la fin de la session de formation. Il faut laisser suffisamment de temps s’écouler pour permettre aux enseignants d’intégrer les nouvelles idées et pratiques dans leur contexte particulier. Étant donné que l’implantation est un processus graduel et irrégulier, il peut être nécessaire de mesurer les progrès réalisés à différents intervalles.
Le niveau 5 aborde le but ultime de la formation : les répercussions sur les élèves. Le DP a-t-il eu un effet quelconque sur l’apprentissage des élèves? Naturellement, l’analyse des résultats d’apprentissage des élèves doit être faite dans la perspective de rechercher les effets directement en lien avec les buts spécifiques poursuivis par la formation offerte aux enseignants. Cependant, en plus des buts visés, l’activité de formation peut produire des résultats indésirables. Dans cette perspective, les évaluations devraient toujours prévoir des mesures variées de l’apprentissage des élèves. Par exemple, l’implantation, par un groupe d’enseignants en formation, de nouvelles stratégies d’enseignement en écriture peut donner lieu à une amélioration des résultats des élèves sur cet aspect particulier. Par contre, une évaluation plus large effectuée au niveau 5 pourrait venir relativiser l’effet positif des nouvelles stratégies en écriture chez les élèves en mettant à jour une baisse de leurs résultats en mathématiques, résultant de la diminution du temps consacré à cette matière par les enseignants en formation.
Les mesures de l’apprentissage des élèves peuvent provenir d’indicateurs de performance comme le rendement scolaire, les tests standardisés ou les évaluations regroupées dans un portfolio. Les résultats obtenus par les élèves sur les dimensions affective (attitudes et comportements) et psychomotrice (habiletés) peuvent être utilisés tout comme les habitudes d’études, le taux d’absentéisme, le taux de réalisation des devoirs et l’observation des comportements en classe. Comme pour les autres niveaux, des questionnaires et des entrevues peuvent être réalisés avec les élèves eux-mêmes, les parents, les enseignants et les directions d’école.
Utilisez la flèche de droite pour passer au contenu suivant.
Les données recueillies à chacun des cinq niveaux sont importantes et peuvent aider grandement à améliorer les activités de développement professionnel des enseignants. Cependant, comme plusieurs chercheurs l’ont réalisé, un constat de succès à un niveau n’amène aucune garantie pour le niveau suivant. Quoique le succès aux niveaux inférieurs soit nécessaire pour l’obtention de résultats positifs au niveau supérieur, ce n’est définitivement pas suffisant. Voilà pourquoi chaque niveau a sa raison d’être. En terminant, sur le plan méthodologique, il faut souligner que le recours à la classification des recherches élaborée par LinguiSystems, combiné à l’utilisation du modèle à 5 niveaux de Guskey, nous a permis d’effectuer une analyse critique rigoureuse des modèles de formation répertoriés.
Pour en apprendre davantage sur nos références, nous vous invitons à consulter aussi la rubrique : Classification des recherches (LinguiSystems, 2006).
La classification des recherches élaborée par LinguiSystems (2006)
Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons utilisé le système de classification des recherches à 4 niveaux élaboré par LinguiSystems (2006) afin d’analyser rigoureusement les stratégies pédagogiques recommandées par les diverses études.
(tiré de Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009, p. 19)
-
Types d’études
- Méta-analyses d’études réalisées avec assignation aléatoire
- Recensions systématiques
Caractéristiques- bien conçu
- contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats
- de nombreuses études (échantillon important)
- conclusions fondées sur des analyses statistiques
- conclusions significatives
-
Types d’études
- Études uniques avec assignation aléatoire
Caractéristiques- bien conçu
- contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats
- de nombreuses études (échantillon important)
- conclusions fondées sur des analyses statistiques
- conclusions significatives
-
Types d’études
- Études uniques sans assignation aléatoire
Caractéristiques- bien conçu
- contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats
-
Types d’études
- Études quasi expérimentales (sans assignation aléatoire ni groupe de contrôle)
Caractéristiques- bien conçu
- contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats
-
Types d’études
- Études corrélationnelles
- Études de cas
- Enquêtes
- Études descriptives
- Analyse de documents
Caractéristiques- devis bien conçu
- devis non expérimental
- analyse qualitative
-
Types d’études
- Rapports de comités d’experts
- Énoncés de consensus
- Communications par des autorités respectées
- Écrits professionnels
Caractéristiques- devis ne permettant pas de comparaison
- n’évalue pas de solution alternative
- n’exclut pas les explications alternatives
Les recherches de niveau 1, qui proviennent d’études qui ont recours à des devis avec assignation aléatoire, sont considérées comme les plus rigoureuses puisqu’elles permettent le meilleur contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats. Selon cette taxonomie, plus on dispose d’études avec assignation aléatoire, plus les résultats sont fiables. C’est la raison pour laquelle se trouvent au niveau 1a les méta-analyses, qui sont des synthèses de recherches quantitatives regroupant de nombreuses études ayant eu recours à des devis expérimentaux où les participants ont été assignés de manière aléatoire dans des groupes comparables pour tester une hypothèse. De la même façon, les études qui font une recension systématique en constituant un échantillon important de ce type de recherches produisent des conclusions qui sont plus significatives.
Les recherches de niveau 1, qui proviennent d’études qui ont recours à des devis avec assignation aléatoire, sont considérées comme les plus rigoureuses puisqu’elles permettent le meilleur contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats. Selon cette taxonomie, plus on dispose d’études avec assignation aléatoire, plus les résultats sont fiables. C’est la raison pour laquelle se trouvent au niveau 1a les méta-analyses, qui sont des synthèses de recherches quantitatives regroupant de nombreuses études ayant eu recours à des devis expérimentaux où les participants ont été assignés de manière aléatoire dans des groupes comparables pour tester une hypothèse. De la même façon, les études qui font une recension systématique en constituant un échantillon important de ce type de recherches produisent des conclusions qui sont plus significatives.
Les recherches de niveau 2 comprennent des études sans assignation aléatoire, mais dont les facteurs pouvant biaiser les résultats sont toujours contrôlés pour tester une hypothèse. On trouve également au niveau 2a des études quasi expérimentales, dans lesquelles les participants n’ont pas été assignés aléatoirement et ne sont pas répartis a priori dans un groupe expérimental et un groupe contrôle. Ces études font quand même appel à une démarche expérimentale visant à tester une hypothèse, mais les chercheurs procèdent à la comparaison des résultats entre deux groupes qui sont formés a posteriori.
Les recherches de niveau 2 comprennent des études sans assignation aléatoire, mais dont les facteurs pouvant biaiser les résultats sont toujours contrôlés pour tester une hypothèse. On trouve également au niveau 2a des études quasi expérimentales, dans lesquelles les participants n’ont pas été assignés aléatoirement et ne sont pas répartis a priori dans un groupe expérimental et un groupe contrôle. Ces études font quand même appel à une démarche expérimentale visant à tester une hypothèse, mais les chercheurs procèdent à la comparaison des résultats entre deux groupes qui sont formés a posteriori.
Les recherches de niveau 3 peuvent prendre la forme d’enquêtes, d’études descriptives, corrélationnelles, d’études de cas qualitatives ou d’analyses de documents. Ces recherches, qualitatives ou quantitatives, peuvent être utilisées pour formuler des hypothèses. Elles ne sont cependant pas utiles pour les mettre à l’épreuve. Cette fonction revient plutôt aux recherches de niveaux 1 et 2 qui sont des recherches appliquées et conduites dans des conditions identiques à celles qui prévalent à l’école. Les chercheurs qui mènent ce type de recherche mesurent l’efficacité d’une stratégie, d’une méthode d’enseignement ou d’un procédé pédagogique. Les études uniques de niveau 2 vérifient à petite échelle et à partir d’un protocole expérimental les résultats de l’application d’une méthode ou d’un programme dans un contexte de classe. Elles sont cependant encore trop limitées pour être généralisables à tout un système scolaire. C’est le rôle des recherches de niveau 1 de vérifier à plus large échelle l’efficacité d’une innovation pédagogique, par exemple, à l’échelle d’une école ou d’un système scolaire. Conduire ce type de recherche est essentiel parce que ce qui peut fonctionner adéquatement de manière isolée, au niveau 2, peut se révéler inefficace en contexte global.
Il est important de noter que les recherches de niveau 3 sont habituellement les plus nombreuses. Ce sont cependant les recherches de niveaux 1 et 2 qui permettent de valider l’efficacité des innovations pédagogiques et curriculaires. Malheureusement, la tendance est d’ignorer cette étape et d’implanter des propositions pédagogiques provenant des recherches de niveau 3 à l’ensemble d’un système scolaire en faisant comme si l’hypothèse de départ avait été démontrée par des recherches de niveaux 1 ou 2. On ne sera donc pas surpris de voir utilisées dans les écoles des stratégies dont l’efficacité n’a jamais été clairement démontrée et de ne pas en voir implantées d’autres dont la valeur a pourtant été largement établie. Les différentes innovations pédagogiques proposées sont souvent présentées comme étant « fondées sur la recherche » comme si elles étaient le résultat le plus achevé de l’évolution des connaissances. Au contraire, et la taxonomie de LinguiSystems peut servir de grille d’analyse à cet égard, plusieurs de ces propositions n’ont aucun fondement empirique solide.
Finalement, on trouve dans les études de niveau 4 des rapports de comités d’experts, des énoncés de consensus ou encore des communications par des autorités respectées. Même si elles se situent au niveau de validité scientifique le plus faible parce qu’elles ne permettent pas de comparaison, et qu’elles ne peuvent ni évaluer de solution alternative ni exclure des explications alternatives, elles présentent des opinions d’experts qui dans certains cas peuvent être importantes.
La possibilité de recourir à une grille d’analyse comme celle de LinguiSystems pour évaluer la rigueur des arguments appuyant les méthodes pédagogiques proposées dans le cadre des activités de formation continue offertes aux enseignants, ainsi que pour reconnaître les données provenant des recherches scientifiques, se révèle particulièrement importante pour les intervenants du monde scolaire.
Utilisez la flèche de droite pour passer au contenu suivant.
Comme le montre le tableau ci-dessus, la classification de LinguiSystems (2006) est basée sur le degré de contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats. Ce tableau présente les études en ordre selon la rigueur avec laquelle ils permettent de contrôler les biais qui peuvent affecter la validité des résultats, allant du niveau de recherche le plus élevé (niveau 1) au plus faible (niveau 4). La taxonomie de LinguiSystems s’appuie sur un principe fondamental selon lequel « plus une recherche est réalisée selon un protocole permettant de contrôler l’influence de certains facteurs, plus les conditions qui en découlent sont fiables et généralisables » (Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009, p. 19).
Résultats
Dans les deux tableaux suivants se trouve le corpus des 50 études recensées que nous avons retenues qui répondaient aux critères d’inclusion de notre synthèse de recherches. Ces 50 études sont classées selon le niveau du degré de contrôle des biais de leur devis de recherche établi lors de l’analyse effectuée à partir de la taxonomie de LinguiSystems (2006). Nous avons ensuite procédé à une seconde analyse pour situer le niveau d’efficacité des activités de formation offertes aux enseignants selon le modèle d’évaluation du développement professionnel à 5 niveaux de Guskey (2000).
Le tableau suivant présente la synthèse des études du corpus classées selon l’analyse combinée à partir de la classification des recherches de LinguiSystems (2006) et du modèle d’évaluation du développement professionnel de Guskey (2000).
Télécharger le document PDF du tableau 2.
Le tableau suivant présente la répartition des études du corpus classées selon l’analyse combinée à partir de la classification des recherches de LinguiSystems (2006) et du modèle d’évaluation du développement professionnel de Guskey (2000).
Tableau 3. Répartition quantifiée des études du corpus classées selon les grilles d’analyse de LinguiSystems (2006) et Guskey (2000)| TYPES D’ÉTUDES SELON LE DEGRÉ DE CONTRÔLE (LinguiSystems, 2006) |
MODÈLE D’ÉVALUATION à 5 NIVEAUX (Guskey, 2000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
|
NIVEAU 1.
|
2 | 1 | 10 | 13 | ||
|
NIVEAU 1a.
|
2 | 1 | 3 | |||
|
NIVEAU 2.
|
||||||
|
NIVEAU 2a.
|
1 | 5 | 6 | |||
|
NIVEAU 3.
|
2 | 1 | 17 | 4 | 24 | |
|
NIVEAU 4.
|
3 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 2 | 3 | 24 | 21 | 50 | |
Les données présentées dans les deux tableaux précédents, et plus particulièrement celles provenant du tableau 3, permettent d’illustrer pourquoi, dans le cadre de cette synthèse de recherches, nous n’avons pu établir, de manière probante et à large échelle, l’efficacité d’un modèle précis de formation des enseignants en littératie sur les résultats des élèves. Alors qu’il est possible de recommander la mise en place d’interventions pédagogiques à partir de données probantes provenant d’études expérimentales qui se situent aux niveaux 1 et 2 de la taxonomie de LinguiSystems, près de la moitié des études (24/50) que nous avons recensées sont des recherches descriptives de niveau 3 qui n’autorisent pas l’établissement d’un lien de causalité entre la formation offerte aux enseignants et les résultats des élèves. De plus, et c’est le problème majeur auquel nous avons été confrontés, les recherches qui traitent du développement professionnel le font habituellement sous l’angle de l’analyse des pratiques enseignantes. Moins souvent analysent-elles les résultats des élèves et rarement abordent-elles les deux.
Synthèse des résultats
1.L’insuffisance de données probantes sur l’efficacité du développement professionnel à large échelle |
2.Les cinq principes favorisant l’efficacité du développement professionnel |
|---|---|
|
L’analyse des études recensées ne nous permet pas d’établir de manière probante, à large échelle, l’efficacité d’un modèle particulier de formation continue des enseignants en lecture et en écriture. La majorité des études sur l’efficacité du développement professionnel demeurent descriptives, produisant peu de résultats quantitatifs généralisables. La réalisation d’études empiriques additionnelles est donc nécessaire pour valider scientifiquement, à large échelle, l’efficacité de la formation continue des enseignants sur les résultats des élèves en lecture et en écriture. |
Il existe des principes communs aux activités de développement professionnel efficaces. En combinant les résultats provenant de plusieurs synthèses de recherche, nous avons pu répertorier cinq principes. Il s’agit de principes généraux qui reposent sur des données probantes et qui s’appliquent tant pour l’enseignement de la lecture que de l’écriture. |
Vous désirez plus d’informations sur ces cinq principes?
Consultez le Rapport intégral ou l’onglet Principes.